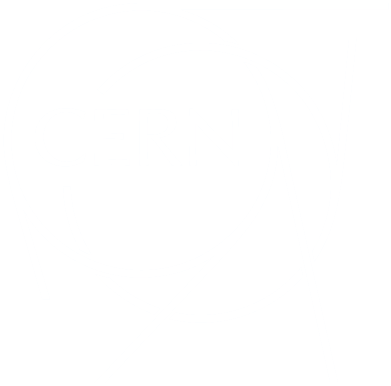Pour l’exploitation proton-proton du LHC, l’année s’est achevée le 18 novembre, sur un bilan impressionnant : 125 fb⁻¹ livrés à ATLAS et CMS, 12,5 fb⁻¹ à LHCb, plus quelques broutilles pour ALICE, dont les besoins en protons sont plus modestes. Ce bilan s’inscrit dans la continuité d’une performance tout aussi spectaculaire en 2024. Depuis la mise en service du LHC, plus de 500 fb⁻¹ ont maintenant été livrés à ATLAS et à CMS. Le trésor ainsi amassé permettra de traverser quatre années sans collisions pendant le troisième long arrêt (LS3), qui, pour le LHC, commencera à la fin du mois de juin 2026.
Outre cette exploitation avec protons, l’année 2025 a été marquée par une très fructueuse campagne d’exploitation avec des ions légers. En juin, il y a eu une période intense de 12 jours de collisions proton-oxygène, oxygène-oxygène et néon-néon, qui ont pu bénéficier d’une excellente qualité et densité de faisceau dans toute la chaîne d’injection, depuis la source d’ions. L’année s’achève à présent avec une campagne plomb-plomb.
Au-delà du LHC, 2025 a été une grande année pour l’ensemble du complexe d’accélérateurs. Le Booster, le PS et le SPS ont alimenté un programme vaste et ambitieux, dans différentes installations : ISOLDE, les installations du PS (Zone Est, n_TOF, AD-ELENA) et celles de la zone Nord, au service de communautés d’utilisateurs très actives : on comptait environ un millier d’utilisateurs à ISOLDE, plusieurs centaines auprès des installations du PS et de l’AD, et plus d’un millier pour la zone Nord. Cette vaste communauté met en lumière l’ampleur, la diversité et la portée mondiale de la production scientifique du CERN.
Ce qui reste impressionnant, même pour ceux d’entre nous qui connaissent bien les machines du CERN, c’est le niveau élevé de fiabilité, de maîtrise opérationnelle et de complexité technique qui caractérise désormais l’ensemble de la chaîne d’accélérateurs. Que l’ensemble du complexe puisse fonctionner à un tel niveau, aussi longtemps, avec une telle disponibilité est tout à fait extraordinaire. C’est le résultat de décennies d’expertise, dans une culture d’amélioration permanente, et d’un effort collectif constant dans tous les domaines techniques et opérationnels.
Tout cela a été rendu possible par un investissement constant dans les ressources humaines et les infrastructures. L’Organisation dispose d’un vivier de talents prometteur, associé à des processus de formation solides, et bénéficie d’une main-d’œuvre profondément engagée au sein des groupes chargés des opérations, de l’ingénierie et des activités techniques. En ce qui concerne l’infrastructure, et même si on n’en parle pas si souvent, les avancées issues de l’amélioration des injecteurs du LHC, d’opérations de consolidation majeures (SMACC, DISMAC) et d’initiatives ciblées telles que le projet Radiation to Electronics (R2E) contribuent elles aussi au niveau de performance relevé aujourd’hui.
La disponibilité reste un enjeu majeur. À cet égard, il faut insister sur deux aspects essentiels : un travail systématique de suivi des défaillances et un investissement continu s’agissant de la fiabilité des équipements. Le faible nombre d’éjections prématurées du faisceau est une excellente illustration de la bonne performance dans ce domaine. Une fois que les faisceaux sont stables, la machine peut fonctionner en régime stable pendant de nombreuses heures – à condition toutefois que des milliers de dispositifs fonctionnent correctement : convertisseurs de puissance, systèmes RF, moniteurs de perte de faisceau, systèmes de protection contre les transitions résistives, cryogénie, et tant d’autres choses.
Tout cela s’inscrit dans une solide culture de visibilité constructive, de suivi attentif et de consolidation ciblée. Une modélisation perfectionnée permet d’analyser en détail les anomalies liées aux faisceaux : UFO (objets tombants non identifiés), ULO (objets statiques non identifiés) ou encore échauffement induit par les faisceaux. Le travail rigoureux accompli par les physiciens appliqués et les ingénieurs, associé à un programme vigoureux de développement machine, permet de continuer à améliorer notre compréhension des systèmes et d’ouvrir de nouvelles possibilités opérationnelles.
Dans tous les groupes techniques – cryogénie, vide, protection des machines, aimants, RF, asservissements, instrumentation des faisceaux, convertisseurs de puissance, refroidissement et ventilation, réseaux électriques, contrôles et autres – le niveau de performance est exceptionnel. Ces systèmes sont à la base du fonctionnement du complexe, et leur maturité et leur robustesse sont des éléments essentiels du succès de la troisième période d’exploitation. Et lorsqu’une anomalie se produit, la capacité d’adaptation, le travail d’équipe et la détermination restent remarquables, et permettent de résoudre le problème, qu’il s’agisse de soufflets qui fuient, de doigts RF tordus ou même de la visite inopinée d’une fouine.
N’oublions pas, bien sûr, les équipes chargées des opérations, qui maintiennent la machine sur la bonne voie, coordonnent les interventions, gèrent les arrêts techniques et préservent un équilibre délicat entre performance, protection et disponibilité. Leur maîtrise des outils, des méthodes et des logiciels essentiels à l’optimisation et à l’exploitation est au cœur des performances de la machine, car ce sont ces équipes qui assurent tout au long de l’année le bon déroulement du cycle opérationnel.
Enfin, autre élément fondamental, la culture de sécurité très forte du CERN. Des enveloppes opérationnelles claires, une surveillance efficace, des systèmes de protection de la machine très solides, des procédures bien définies et une véritable conscience de la complexité et des risques inhérents aux accélérateurs à hautes énergies, sont autant d’éléments qui concourent à assurer une exploitation sûre et fiable.
La performance exceptionnelle de 2025 confirme une fois de plus la capacité du CERN à remplir sa mission première : permettre des découvertes scientifiques de premier plan tout en offrant un lieu de collaboration, d’innovation et de progrès technologique au niveau mondial. À l’approche du LS3, qui sera suivi par l’ère HL-LHC, les réalisations de cette année, qui montrent que nous allons dans la bonne direction, sont de bon augure pour l’avenir.
Le LHC établit un nouveau record mondial de luminosité, avec 125 fb⁻¹ fournis aux expériences ATLAS et CMS en 2025. (Vidéo : CERN)